Précarité et aide alimentaire : regards croisés sur les limites d’un système.
A l’occasion de la sortie de leurs ouvrages respectifs – La France qui a faim et Quand bien manger devient un luxe – Réseau Civam a reçu le 12 mai dernier l’anthropologue Bénédicte Bonzi et le journaliste Benjamin Sèze afin d’échanger sur la précarité alimentaire et ses enjeux (en direct et en visio avec le Réseau Civam). De la stigmatisation de la précarité à la démocratie alimentaire, retrouvez les extraits d’une riche discussion.

Bénédicte Bonzi est docteure en anthropologie sociale, chercheure associée au LAIOS, et cheffe de projets agri-alim chez Auxilia Conseil. Elle étudie l’aide alimentaire, par le prisme du don. Elle a côtoyé sur le terrain les bénévoles des restos du cœur, puis de la croix rouge. Elle a forgé le concept de violence alimentaire. Elle publie en 2023 aux Editions du Seuil « La France qui a faim : le don à l’épreuve des violences alimentaires ».
Benjamin Sèze est journaliste spécialiste des questions sociales, et actuellement responsable éditorial au Secours Catholique, un des premiers réseaux à avoir remis en cause l’aide alimentaire. Il décide d’approfondir ce sujet sous forme d’une enquête journalistique et part à la rencontre de nombreux acteurs du système alimentaire. Il publie en 2023 aux Editions de l’Atelier “Quand bien manger devient un luxe : en finir avec la précarité alimentaire”.
Réseau Civam : Bénédicte, Benjamin, le hasard veut que vous publiiez en même temps deux ouvrages complémentaires sur les questions de précarité alimentaire. Pourquoi ces ouvrages, quelles étaient vos intentions respectives ?
Bénédicte Bonzi : Il s’agit avant tout d’un travail de vulgarisation de ma thèse universitaire en anthropologie. Il s’agit également, à la demande de l’éditeur, Christophe Bonneuil, de relier la question de l’aide alimentaire à la question agricole. Mon travail de terrain auprès des Restos du Cœur représente le gros du livre, mais il y a aussi ce fil conducteur essentiel, qui consiste à ré-ancréer l’aide alimentaire dans le système alimentaire global. Ça fonctionne ensemble, on ne peut pas les dissocier, on ne peut pas répondre à une problématique sans transformer le système.
L’autre chose importante dans ce livre, et la place que j’ai envie de lui donner, c’est la mise en visibilité de tout un système qui reste un peu caché. Notamment parce que l’action des bénévoles est héroïque, et un héros ne se plaint pas. Pour moi c’était important de dévoiler ce que l’aide alimentaire est et ce que l’aide alimentaire fait, de pouvoir rendre palpable la présence de la violence, qui n’est pas liée à l’aide alimentaire mais qui est structurelle, qui surplombe le système alimentaire et qui rejaillit aussi dans l’aide alimentaire. Dans 90 à 95% du temps, les bénévoles de l’aide alimentaire contiennent cette violence, souvent au détriment d’eux-même, mais parfois le non-respect du droit à l’alimentation s’exprime, et ça nous permet de nous rendre compte que cette violence est là et qu’il faut transformer les choses.
Benjamin Sèze : La question de l’alimentation revenait depuis longtemps lorsque je faisais des reportages sur la précarité, les minimas sociaux, la précarité étudiante… Il y a d’ailleurs des témoignages dans le livre qui sont issus d’interviews qui ne portaient pas spécifiquement sur la précarité alimentaire.
Lorsque l’on interroge les personnes en situation de précarité, la question alimentaire arrive très rapidement. Tout simplement parce que l’alimentation est – avec le chauffage – une variable d’ajustement lorsque les ménages ont des budgets trop contraints. On essaye de payer son loyer pour ne pas se faire expulser, ses factures pour ne pas s’endetter, s’habiller correctement pour ne pas se faire stigmatiser. L’alimentation est invisible, une personne qui mange mal ça ne se voit pas, sauf dans des cas extrêmes, du coup quand au milieu du mois les budgets sont très restreints on saute des repas, on se tourne vers le bas coût, on va à l’aide alimentaire.
Il y a un double mouvement depuis 20 ans de décrochage par le bas, qui se traduit notamment par le recours à l’aide alimentaire et de décrochage par le haut, qui se traduit par le développement d’une offre alternative plus qualitative, seine, durable, bio et locale.
Dans le cadre de mes missions au Secours Catholique, j’ai eu l’occasion d’interviewer Olivier de Schutter, ancien rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation. Il a eu deux réflexions qui ont structuré mon livre. D’abord, l’aide alimentation et l’alimentation low cost servent de substitut à des politiques sociales protectrices. Ensuite, il y a une polarisation du système alimentaire. On a un système alimentaire dominant, l’industrie agro-alimentaire, mais il y a un double mouvement depuis 20 ans de décrochage par le bas, qui se traduit notamment par le recours à l’aide alimentaire et de décrochage par le haut, qui se traduit par le développement d’une offre alternative plus qualitative, seine, durable, bio et locale.
Comment en est-on arrivés à plusieurs millions de ménages qui recourent à l’aide alimentaire ? Pourquoi l’alimentation low cost pose problème, au regard des enjeux de santé publique et de justice sociale ? Bien manger n’est plus un problème de riches, c’est une préoccupation partagée mais certains ménages n’ont pas les moyens de mettre en adéquation cette préoccupation avec leur mode de consommation. Comment permettre à tous un accès digne à une alimentation choisie saine et durable ?
J’ai creusé les pistes, en commençant par la grande distribution. Puisqu’elle représente 70% des actes d’achat, ne serait-elle pas la solution la plus efficace pour un accès massif ? On déchante rapidement. Si ce n’est pas réformer le système dominant est-ce que c’est développer les alternatives? Pourquoi l’accessibilité sociale est absente des offres alternatives ? J’ai tiré le fil jusqu’à arriver à l’idée de sécurité sociale de l’alimentation qui termine le livre, ainsi que le lien avec l’agriculture. L’articulation alimentation – agriculture s’est inversée.
Réseau CIVAM : Bénédicte, peux-tu nous dire ce qu’est l’aide alimentaire ? Qui va à l’aide alimentaire et qu’est-ce qu’on y trouve ?
 Bénédicte Bonzi : L’aide alimentaire ce n’est pas le droit à l’alimentation, l’aide alimentaire devrait être une mesure d’urgence. Or l’aide alimentaire depuis trente ans est structurelle, est une composante du système alimentaire.
Bénédicte Bonzi : L’aide alimentaire ce n’est pas le droit à l’alimentation, l’aide alimentaire devrait être une mesure d’urgence. Or l’aide alimentaire depuis trente ans est structurelle, est une composante du système alimentaire.
J’ai identifié plusieurs financements de l’aide alimentaire. L’Europe passant de l’écoulement des surplus agricoles aux appels d’offres. Ce n’est pas de l’aide, c’est un marché.Les collectes dans les supermarchés. Les achats réalisés à partir des dons monétaires et enfin les ramasses encouragées par la loi Garrot qui doivent être regardées de près.
Les structures d’aide alimentaire sont devenues des acteurs de la lutte contre le gaspillage alimentaire au détriment de la lutte contre la précarité. Cela assigne les personnes précaire à la consommation de produits qu’on retire de la vente. En terme d’éthique on touche là pour moi à quelque chose de profondément scandaleux et c’est une forme de violence. On crée un marché de la faim, dans lequel de celui qui reçoit on n’attend plus de retour, puisque ce retour est donné par l’état sous forme de défiscalisation. Il devient une variable d’ajustement d’un système qui déconne d’un bout à l’autre de la chaîne.
“L’aide alimentaire ce n’est pas le droit à l’alimentation, l’aide alimentaire devrait être une mesure d’urgence. Or l’aide alimentaire depuis trente ans est structurelle, est une composante du système alimentaire.”
L’aide alimentaire subit tout ça. Mais l’aide alimentaire, c’est aussi la magie du don dans ses deux aspects. C’est ce que peut créer le don en matière de liens sociaux. Je suis arrivée sur le terrain des Restos du Coeur avec mes pré-requis sur ce que je considère être une bonne alimentation, avec mes préoccupations sur l’agriculture paysanne etc. Aux Restos j’ai vu cette transformation invisible des plats : les personnes les accueillent comme si c’était de la grande gastronomie, alors que les pâtes sont trop cuites, le steak dur… mais il y a la valeur du lien. Le don permet ça, grâce à l’implication des bénévoles. Il y a aussi la face diabolique du don qui peut donner lieu à des dominations. C’est en ce sens là que Mauss disait que le don ne permet pas la justice. C’est en ce sens là qu’il est important de situer l’aide alimentaire dans une forme de résistance à autre chose, en attendant un autre système.
Réseau CIVAM : Benjamin, est-on capable d’appréhender la précarité alimentaire au-delà du dispositif de l’aide alimentaire ?
Benjamin : La précarité alimentaire, au-delà du public de l’aide alimentaire, est difficile à évaluer et elle est assez mal évaluée aujourd’hui. Pour certains acteurs, la première définition de la précarité alimentaire est la contrainte dans l’alimentation, le fait de perdre son autonomie et sa liberté de choix dans l’alimentation. On peut aussi avoir des critères sanitaires, nutritionnels, le fait de ne pas accéder aux fruits et légumes par exemple.
Dans mon livre, j’ai séparé la notion de lutte contre la malbouffe et de lutte contre la précarité alimentaire. Dans le premier cas, on veut amener pour des raisons écologiques ou sanitaires une population à consommer davantage un certain type de produit, par exemple dans le cadre de la lutte contre l’obésité ou le diabète. Dans ce cas là, cela concerne toute la population : on va mettre en place des politiques universelles, une meilleure communication, structurer l’offre, l’éducation. Si une personne veut consommer autrement par préoccupation écologique, sanitaire, mais ne le peut pas, à partir de là on est dans la précarité alimentaire.
“ Pour certains une bonne alimentation va être une alimentation choisie tout simplement : on libère ces ménages de la contrainte et on essaye d’amener toute la population vers une alimentation plus saine.”
Les pouvoirs publics ont longtemps évalué la précarité alimentaire à partir des estimations de fréquentation de l’aide alimentaire. On sait que le phénomène touche bien plus de monde. J’ai pu rencontrer dans mes reportages des personnes qui sont en situation de précarité et qui ne vont pas à l’aide alimentaire ou partiellement et se tournent vers une consommation d’aliments à bas coûts et de faible qualité et en sont parfaitement conscients. Le projet Passerelle à Montreuil, a expérimenté un soutien financier à 200 ménages identifiés comme étant en situation de précarité alimentaire. Sur ces 200 ménages seuls 18% allaient à l’aide alimentaire. Il y a un chiffre qui vient de l’étude INCA 3 de 2015 qui estime à 8 millions le nombre de personnes en situation de précarité alimentaire. Il y a des chercheurs qui travaillent aussi sur les diagnostics de précarité alimentaire, par exemple Simon Vonthron à l’INRAe de Montpellier, qui travaille sur une approche spatiale. Selon la nature des commerces, les possibilités de se déplacer, du profil socio-économique des habitants, il essaye d’identifier ce qui pourrait être des poches de précarité alimentaire. On repère d’abord les territoires, ensuite on va rencontrer les personnes. Mais c’est effectivement une zone grise de précarité alimentaire.
Réseau CIVAM : Benjamin titre “quand bien manger devient un luxe”, qu’est ce que ça veut dire “bien manger” ?
Bénédicte Bonzi : il y a beaucoup de dimensions, je vais retenir la dimension sociale : c’est ne pas manger seul. Ensuite, il y a la question du choix. Je garderais ces deux valeurs fortes : le partage pour re-socialiser son alimentation et la capacité de choisir avec toute la dimension du choix éclairé et de l’éducation populaire.
Benjamin Sèze : Dans le livre il y a un chapitre qui s’appelle du “libre choix au bon choix”. J’y fait part de la tension au sein de la sphère militante entre la liberté de choix et le souci d’efficacité. Si on veut faire une aide financière aux ménages dans le cadre d’un chèque alimentaire par exemple, est-ce qu’il faut le flécher sur une alimentation saine et durable, ou, comme pour la prime de rentrée scolaire, on laisse un libre choix total aux ménages ? Ce débat est intéressant car il tourne autour de ce qu’est une bonne alimentation pour les plus précaires. Pour certains une bonne alimentation va être une alimentation choisie tout simplement : on libère ces ménages de la contrainte et on essaye d’amener toute la population vers une alimentation plus saine. Et il y a ceux qui disent : il n’y a pas le temps, on sait que sur des critères scientifiques, écologiques, sanitaires, une bonne alimentation ça va être du bio, du local, des légumes de saison, etc. C’est d’ailleurs ce vers quoi se dirigent aujourd’hui les ménages qui ont les moyens et on peut se dire que c’est souhaitable pour tout le monde.
Réseau CIVAM : Bénédicte, dans le cadre du don tu fais le parallèle entre les bénéficiaires de l’aide alimentaire et les producteurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Qu’est ce que tu entends par “confiscation de la nourriture” ?
Bénédicte Bonzi : Dans le don il y a plusieurs moments : le don, le contre-don et il y a le moment de la demande. Ce moment est important. Dans le cadre de l’aide alimentaire, les demandes formulées par les personnes sont des demandes de libre-choix, d’autonomie, ce ne sont pas du tout des demandes d’assistance même s’ils sont reconnaissant d’être accueillis. De la même manière, ce qui m’intéresse quand on parle avec les agriculteurs, quel que soit le type d’agriculture, la demande n’est pas du tout de dépendre des aides de la PAC mais de vivre dignement de son revenu et ne pas être embarqués dans une logique de sur-endettement. En ça pour moi il y a un parallèle à faire sur une politique qui choisit de ne pas répondre aux demandes des personnes mais qui par contre est allée répondre précipitamment aux demandes du marché, de l’agro-industrie. Je le redis, le don ne peut pas être la justice et toutes ces pratiques d’aides relèvent de l’endettement. On est dans des pratiques de confiscation de l’autonomie des personnes et d’accaparement des ressources, que ce soit la graine, les outils, la nourriture au bout de la chaîne.
“On est dans des pratiques de confiscation de l’autonomie des personnes et d’accaparement des ressources, que ce soit la graine, les outils, la nourriture au bout de la chaîne.”
Réseau CIVAM : Benjamin, dans le livre tu poses la question “faut-il renoncer à miser sur la grande distribution pour favoriser l’accès de tous à une alimentation saine et durable ?”. Quelles étaient les promesses et quel est le constat aujourd’hui autour d’un circuit qui nourrit 70% de la population ?
Benjamin Sèze : Je suis parti sur une démarche un peu naïve : 70% des actes d’achat se font au sein de la grande distribution, si on imagine un accès massif des ménages à une alimentation saine et durable, pourquoi ne pas utiliser le circuit majoritaire, qui est identifié, qui a un gros maillage territorial, et où les personnes ont l’habitude d’aller ? Je suis allé voir sur le site d’une grande enseigne qui se positionne comme leader d’une transition alimentaire pour tous, quand on lit la page du site c’est formidable, j’ai essayé de les appeler, ils ne m’ont pas répondu. Ensuite j’ai travaillé avec UFC-Que choisir et j’ai mieux compris les stratégies de la grande distribution.
Comment se fait-il que le fait que la grande distribution se soit emparée du bio il y a une dizaine d’années n’a pas contribué à le démocratiser ? Au contraire, la stratégie de la grande distribution c’est de marger à 10% (c’est le minimum légal depuis la loi Egalim) sur les produits phares. Les produits phares sont des produits identifiables, facilement comparables d’un magasin sur l’autre, qui peuvent être soutenus en termes de publicité marketing par des entreprises qui en ont les moyens, donc souvent ce sont des grandes marques, typiquement Coca-cola, Nutella, Danone… Du coup il rattrapent sur les produits pour lesquels c’est plus difficile de comparer d’un magasin à l’autre ou dans le temps : le vrac, les fruits et légumes, la marque distributeur. En moyenne sur les fruits et légumes les grandes surfaces font 50% de marge déjà sur le conventionnel. Sur le bio, ils vont faire des marges encore plus fortes. L’UFC Que choisir a réalisé deux études où ils ont comparé les écarts de marge entre les produits conventionnels et bio, ça pouvait aller de 80 à 150 %. Une pomme conventionnelle et une pomme bio à la sortie du champ, il y avait 74 cts d’écart (au kilo), en rayon de supermarché, il y avait 2€14 d’écart !
L’UFC Que choisir dénonce une stratégie des prix qui va à l’encontre des recommandations nutritionnelles et donc va à l’encontre du consommateur. Cette logique s’illustre de manière flagrante aujourd’hui avec la crise inflationniste où le gouvernement demande à la grande distribution dans le cadre du trimestre anti-inflation de bloquer les prix sur un certain nombre de produits mais sans aller plus loin. C’est sur la base du volontariat. On arrive à des aberrations, par exemple le panier du groupe Auchan qui au mois de mai ne contenait aucun fruit et légume, aucune bouteille de lait, aucune viande fraîche mais avait beaucoup de produits très transformés.
“Il apparaît donc évident que dans ce cadre-là, si on donne plus de place aux personnes en précarité, elles auront beaucoup de réponses pour transformer les choses.”
Participant.e en visio : Quid de celles et ceux qui ne savent pas ou ne peuvent pas cuisiner ?
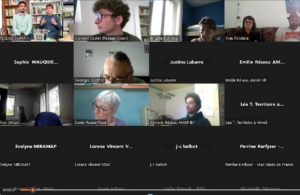 Bénédicte Bonzi : Dans le cadre de la précarité alimentaire, on rencontre beaucoup de personnes qui savent très bien faire à manger mais qui ne peuvent pas le faire parce qu’elles n’ont pas les outils nécessaires : on n’a pas de cuisine quand on est dans un hôtel social ou on a pas le temps. Il y a plein de freins pour pouvoir (se) faire à manger. Ce qu’on entend également des personnes qui ont recours à l’aide alimentaire -notamment des mères de familles qui nous le disent avec les larmes aux yeux – c’est qu’il y a beaucoup de choses qu’on sait, mais quand on ne peut pas faire autrement on ne peut pas se le rappeler tous les jours, tous les matins en ayant le sentiment d’empoisonner nos enfants alors qu’on essaye de faire de notre mieux. Il faut beaucoup de bienveillance et beaucoup de pédagogie pour arriver à comprendre ce qu’est cette situation de précarité, l’incertitude au quotidien, ne pas savoir ce qu’on va mettre dans les assiettes de la famille. C’est extrêmement déstabilisant de vivre dans cette incertitude.”
Bénédicte Bonzi : Dans le cadre de la précarité alimentaire, on rencontre beaucoup de personnes qui savent très bien faire à manger mais qui ne peuvent pas le faire parce qu’elles n’ont pas les outils nécessaires : on n’a pas de cuisine quand on est dans un hôtel social ou on a pas le temps. Il y a plein de freins pour pouvoir (se) faire à manger. Ce qu’on entend également des personnes qui ont recours à l’aide alimentaire -notamment des mères de familles qui nous le disent avec les larmes aux yeux – c’est qu’il y a beaucoup de choses qu’on sait, mais quand on ne peut pas faire autrement on ne peut pas se le rappeler tous les jours, tous les matins en ayant le sentiment d’empoisonner nos enfants alors qu’on essaye de faire de notre mieux. Il faut beaucoup de bienveillance et beaucoup de pédagogie pour arriver à comprendre ce qu’est cette situation de précarité, l’incertitude au quotidien, ne pas savoir ce qu’on va mettre dans les assiettes de la famille. C’est extrêmement déstabilisant de vivre dans cette incertitude.”
Dans les différents ateliers qu’on peut animer avec des personnes qui ont eu ou ont recours à l’aide alimentaire, on commence par leur demander comment elles font. Et, c’est toujours très impressionnant de voir les astuces qu’elles ont pour donner du goût aux plats qu’elles cuisinent, pour arriver à créer un peu de fête ou autre autour d’une alimentation qu’elles n’ont pas choisi. Il apparaît donc évident que dans ce cadre-là, si on leur donne plus de place, elles auront beaucoup de réponses pour transformer les choses.
“On dit aux ménages ce qu’il faut manger alors qu’ils en ont tout à fait conscience mais se heurtent à l’incapacité financière, matérielle de le faire.”
Benjamin Sèze : La question de l’éducation est la seule chose qu’on propose aux ménages précaires pour améliorer leur alimentation en plus de l’aide alimentaire. L’éducation, les conseils nutritionnels, pourquoi pas, c’est un vrai sujet mais ça devient problématique quand ça devient un prétexte pour ne rien faire d’autre et ne pas travailler sur les causes structurelles de la précarité alimentaire. Ce qui est choquant c’est que ça fait partie des politiques de santé notamment dans le cadre du PNNS mais ça vise les pauvres alors que ça concerne tout le monde en cela ça devient stigmatisant. Il y a un côté stigmatisant mais aussi un côté violent. On dit aux ménages ce qu’il faut manger alors qu’ils en ont tout à fait conscience mais se heurtent à l’incapacité financière, matérielle de le faire. Il y a aussi une vision générale stigmatisante sur les pauvres qui “dépensent mal leur argent”. D’ailleurs, c’est comme ça que beaucoup justifient dans leur conscience l’aide alimentaire avec un don en nature plutôt qu’un don financier. Enfin, il y a cette idée que les pauvres ne sauraient pas cuisinier or dans les familles en situation de précarité beaucoup savent cuisiner notamment du fait de leur parcours de vie.
Bénédicte Bonzi : Il est intéressant aussi de regarder les stratégies des personnes. Par exemple, sur les épiceries sociales, on a rarement le droit d’y aller plus de six mois dans l’année. Lors d’un entretien, une personne me disait donc que pendant les mois où elle peut y aller, elle prend plein de boites, plein de produits qui se conservent en anticipation des mois suivants. Elle anticipe et se sert des structures pour faire du stock au cas où. Mais à côté elle a un potager, elle sait cuisiner et elle cuisine. Ainsi quand on voit quelqu’un prendre que des conserves en faisant ses courses, il faut savoir ce qu’il y a derrière.
“L’éducation à l’alimentation pourquoi pas mais ça devient problématique quand c’est un prétexte pour ne rien faire d’autre et ne pas travailler sur les causes structurelles de la précarité alimentaire”
Participant.e en visio : quel est l’ impact de la mauvaise alimentation sur les budgets de santé ? Pour les personnes concernées, peut-on parler de double peine ?
Benjamin Sèze : J’ai fait des recherches sur la prévalence des maladies liées à l’alimentation : obésité, diabète, certaines maladies cardio-vasculaires, certains cancers, la fragilité des os, etc. Certaines études sont très précises concernant le public de l’aide alimentaire et font le lien entre situation de précarité et maladies chroniques liées à l’alimentation. Une étude publiée en 2017 par l’observatoire européen des politiques et des systèmes de santé estimait que les soins de santé liés au diabète coûteraient près de 80 millions d’euro en France. Cela rejoint la notion des coûts cachés de l’alimentation, qu’on retrouve au niveau de la santé et de l’environnement.
Bénédicte Bonzi : La double peine s’entend aussi dans le sens où la perte d’un droit est une perte de droits en cascade, c’est le propos de Wresinski, le fondateur d’ATD Quart Monde. Quand le droit à l’alimentation n’est pas respecté, souvent cela veut dire que par ailleurs le droit au logement n’est pas là, le droit à la santé n’est pas là … On est dans ces ensembles de droits où les personnes ne revendiquent plus rien, où il y a un non-recours assez récurrent sur plein de choses. Par exemple, les différentes structures d’aide alimentaire mettent souvent en place des bus dentaires ou des consultations, et, alors même que les personnes en ont besoin, elles ne viennent pas aux rendez-vous. Cela s’explique certainement parce qu’il est difficile quand on ne sait pas ni où on va manger, ni où on va dormir de prendre le temps du soin pour sa santé, pour ses dents. Cela paraît très secondaire et elles ne se saisissent donc pas de ces outils. Dans les échanges que j’ai eu, j’identifie une espèce de renoncement. On parle de la perte de dignité, voilà comment elle s’exprime concrètement : je glisse, je ne prends plus soin de moi puis les choses empirent.
Participant.e en visio : Que penser de la proposition de sécurité sociale de l’alimentation ?
Bénédicte Bonzi : Il est très important de développer un projet politique fort. La sécurité sociale de l’alimentation vient répondre à ça et vient y répondre en prenant en compte l’urgence de transformer le système agricole (…). On a pas un temps énorme pour se réapproprier les savoir-faire et les savoirs-êtres paysans, pour restaurer les paysages et se dire que demain les tables continueront d’être bien fournies et bien garnies de produits qu’on choisit et qui sont bons pour la planète. Les propositions très concrètes et les questions d’expérimenter des lieux de sécurité sociale de l’alimentation sont posées mais sont écartées par le gouvernement. Il va falloir retrouver du rapport de force et faire en sorte que les résistances se rencontrent : les résistances que développent les bénévoles de l’aide alimentaire et les résistances qui sont développées dans un réseau comme celui-ci et dans toutes les structures de l’agriculture paysanne pour arriver à travailler les choses ensemble et faire advenir autre chose.
Benjamin Sèze : Au niveau politique, je repensais aux lois cadres de l’expérimentation Territoires Zéro Chômeur de longue durée ou récemment une loi d’expérimentation pour les Territoires zéro non-recours aux droits. Quand on regarde Territoires zéro chômeur, à quel point c’est novateur et en décalage avec le système actuel, je me dis que les expérimentations de caisses locales de l’alimentation inspirées de la SSA pourraient tout à fait faire l’objet d’une loi d’expérimentation. Avec ce qui est actuellement lancé avec des caisses locales de l’alimentation à Montpellier, dans le Vaucluse et tout ce qui se prépare en Alsace, en Gironde, à Toulouse, à Saint-Etienne, je me dis que c’est peut-être une piste à creuser, il faut trouver des alliés politiques. Mais effectivement, aujourd’hui les réponses politiques ne sont pas du tout à la hauteur du sujet.
Réseau Civam : Benjamin, Bénédicte, un petit mot de conclusion ?
Benjamin Sèze : La question de la transition alimentaire qui peut amener à une transition agricole peut très bien suivre son chemin en excluant complètement la question de la précarité alimentaire. Il y a des enjeux écologiques et sanitaires qui nous concernent tous au niveau de la société. Par exemple, il y a des acteurs très radicaux en termes de propositions qui viennent du milieu de la santé. Dans le cadre de la lutte contre l’obésité, ils proposent de contraindre les industriels à changer leurs recettes, taxer les produits de mauvaise qualité … Finalement ce combat sur la transition alimentaire qui peut amener à la transition agricole peut donc être menée en dehors de la question de la précarité. Si on n’y prend pas garde, les ménages précaires peuvent encore être laissés sur le côté de cette transition. Avec la sécurité sociale de l’alimentation, il est important aussi d’avoir cette vigilance, d’avoir autour de la table, dans les comités locaux de l’alimentation des ménages en précarité qu’ils puissent faire part de leurs contraintes et de leurs envies pour que dans le cadre de la sécurité sociale de l’alimentation on puisse aussi lutter contre la précarité alimentaire.
Bénédicte Bonzi : J’avais envie de parler de la responsabilité. Dans la mise en visibilité des violences alimentaires, l’enjeu pour moi est aussi d’identifier ceux qui aujourd’hui ont des responsabilités et devraient répondre devant la justice de ce qu’on fait aux personnes sous prétexte de faire des profits. En matière d’éducation populaire, on a beaucoup appris avec des tribunaux populaires comme sur Monstanto. Aujourd’hui il y a un vrai travail à faire pour savoir qui décide de quoi. Cela peut aussi être intéressant, pour créer du rapport de force, de mieux nommer et mieux identifier ceux qui sont en responsabilité. Si ce projet de sécurité sociale de l’alimentation est si difficile, c’est aussi parce qu’on vient toucher, s’attaquer au système agro-industriel qui est colossal.


